
D’après le dernier rapport publié par la FAO, 34,2% des stocks mondiaux sont aujourd’hui surexploités[1]. C’est trois fois plus que dans les années soixante-dix.

À l’instar d’autres secteurs, la pêche a commencé à être industrialisée à partir du XIXe siècle[1]. En Europe d’abord, puis aux États-Unis, au Japon, en Norvège, en Russie etc., l’introduction d’innovations technologiques – telles que les moteurs à vapeur puis à explosion, la mise au point de coques en acier, la réfrigération à bord, le chalut, les navires-usines etc. – a en effet permis aux flottes de démultiplier leur puissance de pêche et de réaliser des prises d’un niveau sans précédent.
En parallèle, des filières ont aussi commencé à se structurer ce qui a favorisé l’ouverture de nouveaux marchés. Grâce à l’essor des conserveries et à la révolution des transports, le poisson peut alors être acheminé plus facilement dans des régions éloignées des côtes[2]. Seules les deux guerres mondiales marquent une pause dans ce processus et offrent aux stocks un répit de courte durée.
En 1946, une conférence consacrée à la surpêche est organisée à Londres. L’essentiel des flottes ayant été détruit durant le conflit, il convient d’anticiper leur reconstruction afin d’éviter une nouvelle « escalade de kilowatts ». Mais faute d’accord entre les pays bordant la mer du Nord, la mise en garde n’est guère suivie d’actes. Au contraire, c’est avec le concours financier des États que les flottes sont reconstituées et, les filières, modernisées.
À cette époque, règne encore le mythe tenace d’un océan inépuisable[3]. Selon cette logique, certains stocks peuvent certes enregistrer des variations de population mais il paraît encore difficilement concevable qu’un tel risque puisse exister à grande échelle. C’est ce changement scalaire qui se produit durant la seconde moitié du XXe siècle, période marquée par une extension mondiale des flottes.
Le rapide accroissement de la pression exercée sur les stocks conduit à une première réduction des prises près des côtes. Grâce à l’essor continu des technologies et en raison du principe de liberté des mers qui prévaut, les flottes suivent un processus de triple expansion: elles commencent d’abord par cibler de nouvelles espèces, puis s’éloignent des côtes avant de mettre en exploitation des stocks des grandes profondeurs. Aujourd’hui, une quatrième dimension est venue s’ajouter : la capacité à détecter du poisson[4].

Provenance des débarquements en 1950. Source: Sea Around Us.

Provenance des débarquements en 2016. Source: Sea Around Us.
Historiquement, les États ont soutenu politiquement et financièrement les changements technologiques intervenus dans le secteur de la pêche. Tel était déjà le cas en Angleterre au XVIIIe siècle comme l’a décrit l’économiste écossais Adam Smith (1723-1790). De même aux Pays-Bas où les aides favorisent la naissance de compagnies privées de pêche[1]. En France, c’est la pêche morutière qui bénéficie de subventions à partir de 1815 afin de reconstruire les flottes qui ont été détruites durant la Révolution et les guerres napoléoniennes[2].
Au XIXe siècle, d’autres pays empruntent cette même voie. En Russie, de jeunes entrepreneurs désireux de développer la chasse industrielle à la baleine sur le modèle norvégien reçoivent ainsi plusieurs milliers de roubles pour mener à bien leurs projets[3]. Simultanément, le Japon – dont le nouveau régime cherche à faire de l’archipel une puissance économique à part entière – encourage l’importation des techniques occidentales, y compris dans le domaine de la pêche[4].
Après la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de reconstruire les flottes et de moderniser les filières conduit les gouvernements à accorder de substantielles aides financières au secteur de la pêche. En retour, ces injections massives de capitaux ont favorisé la surcapacité chronique des flottes (trop de bateaux qui sont également trop puissants) et contribué, de fait, au maintien d’une pression disproportionnée sur des ressources de plus en plus rares.
Dix ans après l’adoption de la Convention sur le droit international de la mer en 1982, la FAO publie un rapport qui dresse un bilan particulièrement négatif. Alors que la possibilité pour les États côtiers d’être souverains au sein de leurs Zones économiques exclusives (les « ZEE » instituées par la Convention de Montego Bay) avait été considérée comme un moyen privilégié de freiner la surpêche, les auteurs notent au contraire que « La situation s’est généralement aggravée par comparaison à celle qui prévalait [en 1982, lors de la signature de la Convention de Montego Bay]. Le gaspillage économique a atteint une ampleur considérable ; on observe une aggravation générale de l’épuisement des ressources, au fur et à mesure du déplacement de l’effort de pêche le long de la chaîne alimentaire ; le milieu marin est de plus en plus détérioré ; les conflits se sont étendus et les difficultés auxquelles les petits pêcheurs se trouvent confrontés se sont aggravées »[5]. Parmi les causes identifiées, les subventions publiques sont particulièrement pointées.
Dès le XIXe siècle, les captures connaissent des fluctuations importantes dans plusieurs zones. Si celles-ci sont alors le plus souvent attribuées à des variations environnementales, certains scientifiques commencent néanmoins à pointer la responsabilité des activités de pêche. C’est un biologiste écossais, John Cleghorn, qui évoque le problème de la surpêche lors d’un congrès de la British Association for the Advancement of Science (BAAS) en 1854. Il y présente ses travaux sur les fluctuations de harengs et conclut qu’un effort de pêche excessif pourrait être à l’origine de la chute des captures.
D’autres pays ayant des flottes industrielles sont confrontés à des difficultés similaires. En Norvège, le biologiste Georg Ossian Sars est officiellement chargé de déterminer les causes des variations des stocks de morues aux îles Lofoten en 1864. De même aux États-Unis où la US Fish Commission est créée en 1871 et reçoit pour mission d’enquêter sur les phénomènes de diminution des poissons dans les eaux côtières et les lacs.
Une erreur serait en revanche d’interpréter ces initiatives comme les marqueurs de préoccupations écologiques. Rappelons en effet que cette demande d’expertise de la part des États vise, à ce moment, à rassurer les banques ayant investi dans le développement d’un secteur jugé prometteur[1]. Autrement dit, la science halieutique telle qu’elle se structure doit alors répondre à des impératifs d’exploitation et non de conservation.
Confrontés aux mêmes difficultés, plusieurs États – Allemagne, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Russie et Suède – décident de fonder le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) en 1902. Bien qu’il n’ait pas encore le statut d’organisation internationale – il faut attendre 1964 -, le CIEM constitue l’une des toutes premières initiatives multilatérales en matière scientifique. À sa création, le conseil créé deux comités respectivement chargés d’étudier A) la migration d’espèces comestibles et B) le problème de la surexploitation des ressources par les chalutiers opérant en mer du Nord. Les membres de ce dernier proposèrent, pour la première fois, une définition de la surpêche mais qui fut vivement critiquée car jugée trop simpliste[2].
Simultanément, l’industrialisation galopante du secteur de la pêche se traduit également par le déclin spectaculaire de certaines espèces emblématiques. Durant les années 1930, la disparition des populations de baleines due à la chasse intensive conduit, par exemple, à l’adoption de deux conventions internationales : 1) la Convention pour la réglementation de la chasse à la baleine conclue en 1931 à Genève et 2) l’Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Londres en 1937. Cependant, les principales nations baleinières – Allemagne, Chili, Japon et URSS – n’étant pas parties à ces accords, les deux dispositifs échouent.
Citons encore le cas de la Commission internationale du flétan du Pacifique. Créée en 1923, elle a été instituée par le traité sur le flétan conclu entre le Canada et les États-Unis afin de mettre en place des mesures de conservation pour protéger cette espèce évoluant dans le nord de l’océan Pacifique[3].
Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ont été créées afin de gérer les stocks de poisson, soit en suivant une approche par espèce, soit par aire géographique. Comme le signale le juriste Patrick Chaumette, « il s’agit de maintenir les stocks à un niveau optimal permettant un maximum de captures, d’augmenter les connaissances scientifiques sur les stocks commercialisables et de faciliter la coopération des États membres riverains ou exploitant la ressource » [4]. Pour ce faire, les ORGP – qui sont aujourd’hui une cinquantaine – mobilisent les outils développés par les scientifiques des pêches après-guerre, en particulier le fameux Rendement Maximal Durable (RMD).
Bien que leur rôle ait été confirmé par la Convention sur le droit international de la mer adoptée à Montego Bay en 1982 et, plus encore, par les Accords de l’Organisation des Nations unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs, toutes les ORGP n’ont pas le même niveau d’efficacité[5]. Celui-ci dépend à la fois des normes qu’elles ont instaurées et du niveau de coopération dont les États qui les composent font preuve.
Notes et Références

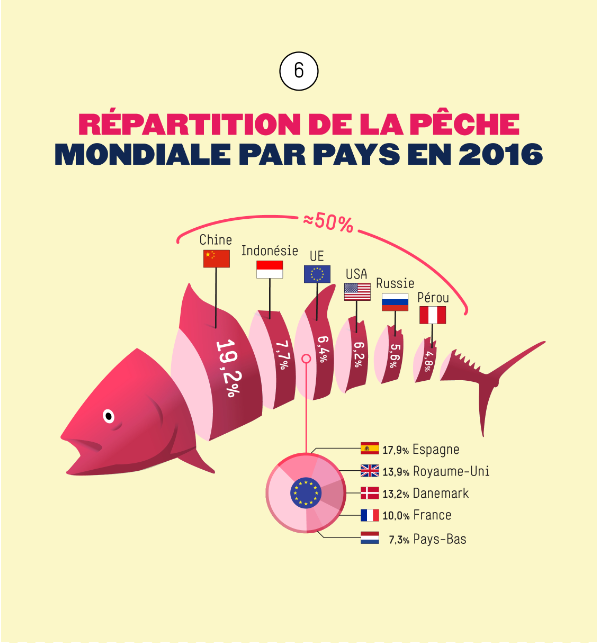

Je découvre les ressources de BLOOM